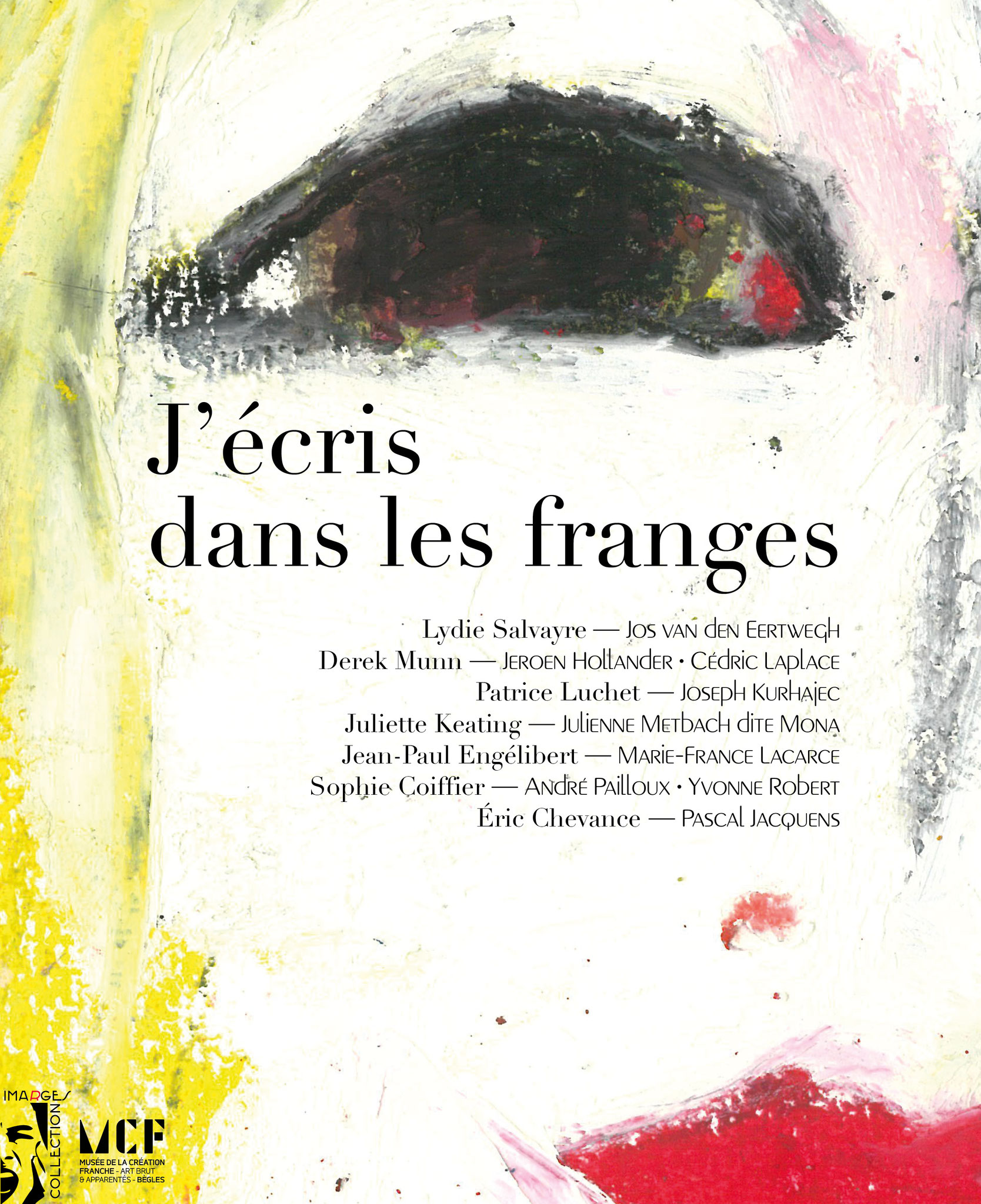Ce recueil composé de 42 nouvelles indépendantes les unes des autres, tant du point de vue du sujet que du style, rassemble la plupart des formes courtes de l’auteur écrites depuis le début des années 80.
Chaque nouvelle met en scène un personnage, un homme, une femme, parfois un enfant, confronté à une situation banale du quotidien (une visite au musée, une panne de voiture, un rêve), un événement douloureux où son existence bascule (la maladie, le deuil, un licenciement ou une rupture amoureuse) ou encore une situation d’exclusion (le fait d’être étranger, la folie).
Certaines nouvelles glissent vers le conte ou le poème, la dystopie ou le récit onirique.Cependant, de la variété des formes, une unité se dégage, celle d’un monde où l’être humain est confronté à la précarité et à la violence d’une société qui ne respecte ni ses rythmes ni ses aspirations personnels, où la vie se résume, comme dans la nouvelle « Sois funambule » à subir l’injonction de suivre une route déjà tracée en tentant de ne pas chûter.
Écrivain de l’introspection, Derek Munn excelle dans l’art de représenter les paysages mentaux et les flux de conscience de ses personnages.
Dans ces nouvelles, comme il le fait dans ses romans, il s’attache à traquer l’infime, à nommer l’indicible : des personnages qui doutent, ne parviennent pas toujours à exprimer ce qu’ils pensent ou ressentent, comme s’ils se trouvaient en perpétuel décalage avec une réalité dans laquelle ils peinent à s’incarner. Comme s’ils restaient prisonniers de leurs pensées sans parvenir à les partager.
Au fil du recueil, la langue subtilement poétique de Derek Munn s’adapte, se met au service de l’existence intime des personnages, reflétant leur fragilité, parfois jusqu’à traduire le désordre mental.
C’est sans doute la dernière nouvelle qui, donnant son titre au recueil, nous en offre la clé : une rencontre sans suite de deux personnes dans un bar. Après le départ de la première, l’autre reste seul :
« Je lisse la serviette. Toi, tu oublieras, moi, je me souviendrai. Soudain ma bouche est pleine, encombrée de paroles que j’ai du mal à avaler ».
Certaines nouvelles de ce recueil ont déjà été publiées sous le titre Un Paysage ordinaire (indisponible aujourd’hui - Prix Place aux Nouvelles 2015), d’autres en revues ou aux éditions L’Ire des marges dans la collection vies minuscules. D’autres encore sont inédites à ce jour.
EXTRAIT
LA BRÊCHE
Je marche, sur une route nocturne, j’ai froid, j’ai peur, left right left right, un pas après un autre, une image après une autre. J’oscille entre le trottoir, la chaussée, il y a très peu de circulation, il doit être autour de minuit, c’est tard dans un village comme celui-ci.
Il y a du vertige dans mon avancée, une angoisse éblouie. J’imagine des plans, des cadrages, je fouille mon ombre, mes ombres, j’entre dans le jeu des réverbères avec l’impression de me défaire de la banalité des couleurs, de m’immerger dans la singularité du noir, du blanc, un immense vocabulaire de gris.
Ce sont les premières images du film invisible que depuis ce moment je n’ai cessé de tourner, une longue pellicule de terre battue, d’asphalte, de poussière, une errance sans scénario. Le début de mon cinéma, peut-être aussi de mon écriture.
Mais pour avoir conscience d’un début, il faut un avant. C’était les inévitables Disney, des films en famille, la corvée de The sound of music pour accompagner ma sœur, quelques films de guerre avec mon père. Beaux, gais, émouvants, drôles, divertissants comme une partie de jeu de société. Du spectacle, le grand écran comme le théâtre à Noël, un bonbon, un plaisir vif mais transitoire, un cadeau pour récompenser pour la vie ordinaire, tout ce temps gâché à l’école.
Toutefois, c’est grâce à un professeur d’anglais que je me trouve, la nuit, sur cette route. Ses conseils, livres, musique, cinéma ouvrent une brèche par laquelle sortir de l’impasse de ma scolarité. Il nous a encouragés à regarder une nouvelle émission, la diffusion de films obscurs, étranges, étrangers, avec sous-titres. C’est sur la deuxième chaîne de la BBC, que notre vieux poste à la maison ne capte pas. Je ne sais pas pourquoi j’ai insisté, ni d’où vient l’importance qu’ont déjà pour moi ces films inconnus, mais j’obtiens la permission d’aller regarder l’émission chez mes grands-parents, je me sens un peu coupable, c’est tard pour eux, un dérangement, mais ils ont dit oui.
Entre les deux maisons, quarante-cinq minutes plus ou moins, selon mon humeur, mon urgence, le temps. Cette route, je la connais par cœur, je l’ai parcourue en toutes saisons, mais plutôt en journée. Maintenant elle est nocturne, parce que les films commencent tard, parce que même en plein après-midi le cinéma a toujours quelque chose de nocturne, parce que ma mémoire est péremptoire.
C’est toujours dans le sens du retour que je marche, toujours au même endroit, là où le noir est plus luxuriant, la végétation plus ambiguë, où je préfère marcher sur la ligne blanche. Un carrefour, à droite il y a un banc public au bord d’une pauvreté d’herbe, mon imagination y ajoute une tache verte que la nuit aurait estompée. Parfois il pleut, jamais avec acharnement, juste une pluie fine, moqueuse de ma présence à cette heure. Une fois, le banc est occupé. Une bande de garçons plus grands que moi, avec l’arrogance du nombre, de l’âge, de l’alcool, profère des insultes, des menaces. Ils ne me font rien, je continue, je rejoue la scène, du vertige dans mon avancée, une angoisse éblouie. Il me semble voir le silence qui m’accompagne se rétracter, se déformer à chaque pas, il y a des gravillons de musique incrustés dans le bitume, des images qui s’enfuient avant que je ne les saisisse.
Le début de mon cinéma, peut-être aussi de mon écriture. Je reviens constamment là, j’oscille entre le trottoir, la chaussée, entre une réponse, une question, je marche le générique de mon film invisible, mais le vrai héros de cette séquence – même si sa participation a été un peu éclipsée au montage – est mon grand-père, c’est lui qui veille, qui regarde les films avec moi. Je ne sais plus combien de fois, pendant combien de semaines. J’ai peur de sa réaction, j’appréhende l’ennui, le mien, le sien, je mésestime sa curiosité. Sorte de viatique, ce partage m’apporte plus que je n’ai encore compris.
(...)